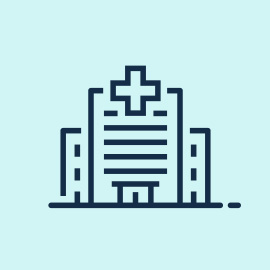#2 - Les freins à la mise en place du Treat-to-Target
Introduction par le Pr Combe
Le Treat-to-Target (T2T) est un concept de stratégie thérapeutique qui a fait la preuve de son efficacité dans la prise en charge de la Polyarthrite Rhumatoïde (PR). Il est démontré que l’application de ce concept est aussi importante pour l’évolution de la maladie à moyen terme, que le choix même des médicaments dans le traitement de la PR. Le T2T consiste d’abord à définir un objectif thérapeutique (rémission clinique ou faible activité), puis à suivre étroitement le patient tant que l’on n’a pas atteint cet objectif et enfin à adapter le traitement si on ne l’atteint pas dans un délai de 6 mois. En dépit de son importance il s’avère que beaucoup de patients ne bénéficient pas du T2T pour des raisons variables liées aux patients eux-mêmes, aux rhumatologues ou à l’organisation des soins.
La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (PR) a énormément évolué au cours de ces 30 dernières années, notamment grâce à l’arrivée du Treat-to-Target (T2T) par le biais entre autres de TICORA*. (1)
Bien que cette stratégie ait démontré son efficacité versus une prise en charge standard dans des études, il semblerait que son implémentation reste sous-optimale. (2)
Un comité national d’experts scientifiques** a cherché à comprendre ce qui pouvait gêner la mise en pratique du T2T.
En mars 2022, ils ont identifié 8 freins :
1. Contraintes de temps et de ressources organisationnelles
2. Présence de comorbidités chez le patient
3. Craintes vis-à-vis de la tolérance des médicaments et peur de surtraitement
4. Manque d’adhérence du patient à la stratégie de prise en charge
5. Manque de décision partagée autour de l’objectif thérapeutique
6. Utilisation insuffisante d’outils permettant de convaincre le patient de suivre une approche T2T
7. Manque d’outils/scores d’évaluation (pour les professionnels de santé), d’autoévaluation (pour les patients) de l’activité de la maladie et de checklists de suivi adaptés
8. Méconnaissance du rhumatologue de l’importance d’une approche T2T et manque de conviction
* TICORA : essai clinique ayant démontré l’amélioration des variables d’activité de la maladie par le biais de la stratégie T2T (DMARDs conventionnels avec intensification thérapeutique tous les 3 mois chez les patients en début de prise en charge de leur PR) par rapport à la prise en charge classique. (3)
** Pr Bruno FAUTREL (Paris), Pr Jean SIBILIA (Strasbourg), Pr Philippe GOUPILLE (Tours), Pr Valérie DEVAUCHELLE (Brest), Pr Cécile GAUJOUX-VIALA (Nîmes), Pr Adeline RUYSSEN WITRAND (Toulouse), Pr Philippe GAUDIN (Grenoble)
Ces freins peuvent être classés en 4 catégories :
Avis du Pr Combe sur les freins liés à l’organisation des soins
La prise en charge (PEC) d’un patient atteint de PR nécessite des consultations longues, notamment au diagnostic ou lorsque la maladie est active et nécessite des adaptations thérapeutiques. Notre système de soins français qui privilégie dans la nomenclature les actes techniques aux actes intellectuels, est un frein majeur à la mise en place du T2T en pratique courante.
De plus, les longs délais d’attente avant d’obtenir une consultation en rhumatologie limitent la PEC efficace du patient en phase active, qui est une semi-urgence médicale, qui nécessite des consultations longues mais aussi rapprochées.
Contraintes liées aux organisations de soins
Un des principaux freins à l’instauration du T2T est l’organisation variable au sein des structures de soins du côté du praticien mais également du côté de la structure.
En effet, certaines prises en charge nécessitent une organisation autour d’un plateau technique, avec une infirmière de consultation pour regrouper en plus de l’avis diagnostique, des examens complémentaires.
L’organisation de plusieurs consultations successives peut être envisagée afin d’éviter une hospitalisation pour effectuer un diagnostic initial avant la prise en charge thérapeutique. (4)
Consultation : des délais d’attente variables
Une consultation ayant lieu dans les 12 premières semaines suivant l’apparition des symptômes serait associée à une destruction articulaire moindre et à une plus grande probabilité d’atteindre la rémission sans avoir recours aux DMARDs. (5)
En France, le délai moyen d’attente déclarée entre la prise de rendez-vous et la consultation rhumatologique était variable.
Contraintes de temps
Un temps d’échange trop court en raison de la multitude de sujets à aborder
- Côté patient
Selon une enquête réalisée, en 2009, par la DREES, la durée de consultation en rhumatologie de ville était relativement variable. La moitié des consultations durait entre 15 et 30 minutes avec une moyenne de 24 minutes. Compte tenu de l’ensemble des sujets à aborder, ce temps peut paraître assez court pour permettre au patient un réel échange avec son praticien. (7)
Cela était confirmé par une enquête menée dans 17 pays auprès de 1 805 patients atteints de PR et suivis par un rhumatologue. Plus d’un patient sur 5 (21%) estimait qu’il n’avait pas assez de temps pour faire part de ses préoccupations ou qu’il ne rencontrait pas son médecin aussi souvent qu’il le souhaitait. (8)
Avis du Pr Combe sur les freins liés aux rhumatologues :
Le rhumatologue connaît ou plutôt a « entendu parler » de la stratégie T2T dans la PR, mais il en évalue souvent mal l’importance, ne se l’approprie pas suffisamment et l’applique pas ou imparfaitement en pratique courante. Par exemple, alors qu’il est recommandé d’utiliser un indice composite de mesure de l’activité de la PR (DAS28, SDAI, CDAI) à chaque consultation, moins de 50% des rhumatologues français le réalise. Ceci conduit souvent à renouveler un traitement alors que la PR est en activité modérée persistante.
Le contrôle étroit (typiquement tous les 1 à 3 mois) de l’activité de la maladie en cas de PR active est également insuffisamment programmé, par manque de temps et en raison d’agendas surchargés. Il serait nécessaire que tout rhumatologue puisse inscrire des créneaux de rendez-vous dédiés à ce type de patients, comme certains le font d’ailleurs très bien.
Méconnaissance de l’importance de l’approche T2T & manque de conviction
Méconnaissance de l’importance de l’approche T2T (9)
En prévision d’un essai clinique randomisé sur l’implémentation de la stratégie T2T en PR, une étude qualitative a été menée auprès de 12 rhumatologues américains pour comprendre la façon dont ils utilisaient le T2T dans leur pratique clinique.
Alors que tous disaient pratiquer le T2T, il s’est avéré qu’ils étaient peu nombreux à en suivre les principes fondamentaux.
Il pourrait s’avérer judicieux d’intégrer le T2T à la formation médicale continue pour qu’un plus grand nombre de praticiens soient sensibilisés aux principes fondamentaux de cette approche, en particulier concernant la prise de décision partagée.
Manque de conviction (10)
Une enquête a été menée auprès de 78 rhumatologues canadiens à propos des recommandations T2T. Une échelle de Likert en 4 points (« jamais », « peu souvent », « très souvent », « toujours ») a permis d’évaluer l’application de chaque recommandation dans la pratique clinique. Les médecins ayant répondu « jamais » ou « peu souvent » ont été interrogés sur leurs habitudes actuelles par rapport à chaque recommandation individuelle et devaient indiquer s’ils étaient prêts à modifier leur pratique à l’avenir.
Des agendas chargés de consultations (#5) et un manque de conviction par rapport à l’usage de scores composites (#6) constituaient les principales objections de ce panel de médecins par rapport à la mise en place du T2T.
Utilisation insuffisante des outils d’évaluation
Des scores composites pour encourager l’adhérence au T2T ?
Il a été constaté que l’implémentation de la stratégie T2T déclinait au cours du temps. En utilisant systématiquement un score composite validé, le praticien mettrait régulièrement en application le T2T, tout en mesurant l’activité de la maladie et en assurant une prise en charge optimale à chaque patient. (11)
L’importance de scores composites validés pour l’évaluation de la prise en charge des patients
Les différents scores composites de mesure de l’activité de la PR (DAS28, SDAI, CDAI et les critères de réponses ACR20/50/70) sont validés et ont montré des propriétés psychométriques similaires. En pratique clinique courante, l’important est que l’activité de la PR soit contrôlée par un outil de mesure, score composite standardisé et validé, aussi souvent que possible et que le contrôle de la maladie soit maintenu le plus longtemps possible.
Cette mesure de l’activité de la maladie aide le rhumatologue à la décision thérapeutique.
Cependant, un indice composite ne doit jamais s’interpréter de manière isolée : le rhumatologue doit apprécier chacune de ses composantes, en prenant en compte l’histoire du patient et un examen clinique/physique rigoureux. (12)
Par ailleurs, une étude néerlandaise a comparé l’efficacité d’un ajustement thérapeutique basé sur le score composite DAS (Disease Activity Score) [groupe A] versus l’appréciation du praticien [groupe B] chez 435 patients en début de PR (âge moyen : 54 ans ; 72% femmes).
Dans le groupe A, le traitement était ajusté systématiquement afin d’atteindre une faible activité de la maladie (DAS <2,4). Dans le groupe B, l’ajustement thérapeutique n’était pas systématique.
Grâce à la surveillance régulière de l’activité de leur maladie, il a été montré que les patients du groupe A présentaient de meilleurs résultats cliniques que les patients du groupe B qui recevaient des soins de routine.
Les auteurs ont pu en conclure qu’une prise en charge de la PR basée sur un recours systématique au DAS pouvait entraîner une amélioration significative au niveau clinique et permettre une régression de la progression des lésions articulaires. (13)
Des scores prenant en compte les aspects de la maladie les plus problématiques pour les patients ?
L’approche T2T se concentre majoritairement sur la réduction de l’inflammation pour prévenir les lésions articulaires et l’incapacité physique. Cependant, les patients considèrent que les aspects les plus importants de leur maladie sont : (14)
Il serait peut-être judicieux d’envisager le recours à d’autres outils pour obtenir une évaluation plus complète du bien-être du patient. Cela pourrait avoir pour conséquence une meilleure adhésion thérapeutique des patients. (15)
Avis du Pr Combe sur les freins liés à la relation rhumatologue-patient :
La relation rhumatologue-patient dans le cadre d’une décision partagée, est essentielle pour la réussite de la prise en charge de la PR. Ceci est particulièrement important au début de la maladie et lors des phases actives où il y a souvent beaucoup d’éléments à prendre en compte.
Le rhumatologue doit gagner la confiance de son patient, et celui-ci doit comprendre la stratégie et adhérer aux choix stratégiques proposés.
Ainsi, l’objectif thérapeutique individuel, qui est un élément clé de la stratégie T2T, semble rarement discuté avec le patient. Il en est de même de la nécessité de l’adaptation stratégique lorsque l’on n’est pas à l’objectif fixé et que la maladie est toujours active.
De plus, la discordance classique entre les objectifs du praticien qui sont de réduire l’activité de la maladie (articulations gonflées, CRP ….) et ceux du patient (douleur, fatigue, qualité de vie..) contribue aux freins de l’implantation de la stratégie, en l’absence de dialogue constructif.
Manque de décision partagée autour de l’objectif thérapeutique
L’objectif du traitement de la Polyarthrite Rhumatoïde est la rémission (absence d’activité de la maladie).
Bien que des progrès aient été faits pour trouver une définition consensuelle de cette rémission, plusieurs versions persistent comme la rémission ACR/EULAR qui peut être booléenne :
- ≤1 articulation gonflée
- ≤1 une articulation douloureuse
- ≤1mg/dl de CRP
- Évaluation globale de la maladie par le patient ≤1 (sur un EVA*** de 0 à 10)
Ou la rémission basée sur le SDAI (critères très stricts et difficiles à obtenir) ou en utilisant des critères plus permissifs comme le DAS28. (16,17,18)
La prise en charge optimale des patients atteints de PR nécessite une concertation entre le rhumatologue et le patient, dans le cadre d’une décision médicale partagée reposant sur l’information et l’éducation du patient. La décision médicale partagée est au cœur de l’alliance thérapeutique, nécessaire et même indispensable pour une prise en charge optimale des patients souffrant de PR (comme pour toute maladie chronique). L’éducation thérapeutique est un élément important dans l’autonomisation du patient et peut être réalisée au cours de séances formalisées d’éducation thérapeutique, mais également en dehors de ces séances. (12)
Une étude américaine basée sur un questionnaire anonyme rempli en ligne par 907 personnes (âge moyen : 58 ans ; moyenne de 11 ans depuis le diagnostic de PR ; 90% de femmes) a cherché à en savoir plus sur l’importance de la décision médicale partagée. La majorité des participants (63%) a indiqué que les objectifs thérapeutiques ne faisaient pas partie des thématiques qu’ils abordaient avec leurs rhumatologues.
Pourtant, les patients qui discutaient des objectifs de traitement avec leur rhumatologue étaient davantage susceptibles de : (19)
*** EVA : Échelle Visuelle Analogique
Craintes vis-à-vis de la tolérance des médicaments
La tolérance du médicament constitue un critère important lors du choix d’un traitement de la PR pour le rhumatologue comme pour le patient.
Point de vue du patient (20)
6 135 patients atteints de PR ont été interrogés sur leurs préférences de traitement selon 11 items. Seule la moitié des participants à l’étude (53,3%) se disaient satisfaits du contrôle de leur maladie avec leur traitement actuel. Pourtant, près de trois quarts d’entre eux (72,5%) ne souhaitaient pas changer de traitement par peur d’éventuels effets indésirables.
Point de vue du rhumatologue (21)
Dans une enquête internationale menée auprès de 1 736 médecins prenant en charge des patients atteints de PR, 70% d’entre eux indiquaient que les effets indésirables associés au traitement étaient à l’origine du manque d’adhésion thérapeutique de leurs patients. Dans l’arsenal thérapeutique actuellement disponible, le plus grand souhait d’une majorité de rhumatologues (76%) serait d’améliorer la tolérance des traitements de la PR. Il existe un réel enjeu vis-à-vis de la tolérance lors du choix de la prise en charge.
Réticence relative à une rotation thérapeutique
La stratégie de prise en charge T2T s’oppose à l’inertie thérapeutique. En effet, en cas de réponse insuffisante, elle recommande d’augmenter la dose d’un traitement en cours ou de modifier le type de traitement afin d’optimiser le contrôle sur la PR. (20)
Cependant, par peur de perdre le contrôle de la maladie, cette rotation thérapeutique n’est souvent pas assurée. Une enquête réalisée auprès de 249 patients dont 70% avec une PR active selon le score RAPID3* a pu le constater. (22)
- 62% des patients atteints de PR très active ne se voyaient pas proposer de changement de traitement par leur rhumatologue
- Parmi les patients qui se voyaient proposer un changement de traitement (38%), près de 1/3 d’entre eux le refusait.
Avis du Pr Combe sur les freins liés aux patients :
Le patient lui même peut être un frein à l’implémentation de la stratégie T2T en pratique courante :
• D’une part , par son état de santé général et notamment la présence de comorbidités associées à la PR, qui peuvent gêner les adaptations thérapeutiques nécessaires,
• Mais aussi par une certaine satisfaction lorsqu’il se voit amélioré mais ne juge pas utile d’aller plus loin, en raison souvent d’une peur des effets secondaires de nouveaux traitements éventuels,
• Ou encore par une adhérence insuffisante aux schémas thérapeutiques proposés, ce qui est fréquent dans les maladies chroniques.
Présence de comorbidités
Facteur prédictif indépendant d’échec de la mise en place de la stratégie T2T
Pendant 2 ans, une étude a été menée auprès de 439 patients atteints de PR issus de 10 pays différents (cohorte RA BIODAM). Le protocole exigeait que la stratégie T2T soit suivie par les rhumatologues qui assuraient leur prise en charge. Un nombre plus élevé de comorbidités chez le patient constituait un facteur prédictif indépendant d’échec de la mise en place de la stratégie T2T, avec un échec d’adhérence constaté dans 40% des cas. (23)
Explications plausibles de ce lien de causalité
Les défis associés à la prise en charge d’un patient atteint de PR et présentant des comorbidités sont multiples : (24)
- Détection difficile des comorbidités,
- Délai avant d’être référé à un spécialiste de la prise en charge des comorbidités,
- Comorbidités sous-diagnostiquées
- Prise en charge inadaptée des comorbidités,
- Problème de suivi entre les différents spécialistes
- Absence de recommandations dédiées pour améliorer la prise en charge des comorbidités associées chez les patients PR.
Une prise en charge adaptée des pathologies coexistantes chez les patients atteints de PR permettrait d’atténuer les effets de ces comorbidités sur la PR elle même. (11)
Discordance entre professionnel de santé et le patient autour de l’objectif thérapeutique
Selon une étude observationnelle impliquant 195 patients atteints de PR et 190 cliniciens :
40,6% des patients avaient comme objectif principal d’avoir une vie sociale qui ne serait pas impactée par la PR, tandis que seulement 15,3% des médecins considéraient cette composante comme cible prioritaire du traitement. (25)
Par ailleurs, dans une étude réalisée sur 249 patients en 2020, il a été indiqué que les patients souhaitent être plus impliqués dans leur prise en charge. En effet, 72% des patients ayant une activité de la maladie sévère souhaitent être activement impliqués dans le processus de prise de décision. (22)
Une utilisation des PROs encore timide
L’utilisation des PROs (ou Patient-Reported Outcomes) dans la pratique clinique est encore relativement timide en France. (26)
Pourtant, ils fournissent de précieuses informations sur l’état des patients qui s’avèrent complémentaires à l’évaluation clinique et aux scores composites. Ces PROs peuvent également servir à orienter la prise en charge, par exemple, en indiquant la nécessité de rapprocher des consultations ou le besoin de changer de traitement. Cela est particulièrement important chez les patients atteints de PR qui ne parviennent pas à atteindre la rémission ou une faible activité de la maladie.
Une utilisation appropriée de ces PROs permettrait de se focaliser davantage sur l’impact de la PR sur la vie des patients ainsi que sur leurs ressentis. Cela aurait pour conséquence de faciliter la prise de décision partagée et d’améliorer la qualité de la prise en charge via une approche plus centrée sur le patient. (27)
Des patients volontaires et en demande
Associer PROs et technologie pourrait faciliter leur intégration dans la pratique clinique quotidienne en rhumatologie. Cela a été confirmé récemment par une étude (N=100 patients) sur l’intérêt du développement d’une application mobile destinée aux patients et relative à l’auto-gestion et l’auto-évaluation de la PR. (28)
Manque d’outils pour convaincre de l’intérêt de la stratégie T2T
Certains patients atteints de PR ne disposent pas de suffisamment d’informations concernant leur maladie, l’arsenal thérapeutique ou la stratégie de prise en charge T2T.
Une étude réalisée sur 111 patients atteints de PR a montré que seuls 56% des patients comprenaient bien leur maladie et 91% des patients interrogés n’avaient jamais entendu parler du T2T. (29)
Au cours d’une autre étude, il a été possible d’approfondir ces constatations lors d’entretiens qualitatifs auprès de 20 patients atteints de PR. Les patients avouaient ne pas comprendre le but ou la signification des examens prescrits par leur médecin (signification des analyses de sang et des imageries par exemple).
Les patients ont indiqué que ce manque d’informations était gênant et qu’ils aimeraient également en savoir plus sur l’impact de leurs comorbidités sur la prise en charge de leur PR. (30)
Il s’avère essentiel de pallier à ce manque de connaissances pour éviter que cela n’altère l’adhésion thérapeutique. Cependant, compte tenu des temps de consultations restreints, il serait intéressant de fournir aux rhumatologues des outils pédagogiques sur lesquels s’appuyer pour convaincre leurs patients de l’intérêt de la stratégie T2T dans la prise en charge de leur PR. (31)
Conclusion du Pr Combe :
La stratégie T2T est un élément essentiel de la prise en charge d’un patient atteint de PR, comme dans d’autres maladies chroniques. Malheureusement elle est actuellement insuffisamment appliquée en pratique courante, avec un certain nombre de freins qui ont été clairement identifiés. Beaucoup d’entre eux pourraient être contournés par un meilleur dialogue et une meilleure communication médecin-malade. Le rhumatologue, s’il est convaincu de l’importance de l’application stricte du T2T, a un rôle clé à jouer puisqu’il est au centre de la prise en charge de la maladie.
Lexique
DMARDs : Disease-modifying antirheumatic drugs
PR : Polyarthrite Rhumatoïde
T2T : Treat-to-Target
- Ford JA, Solomon DH. Challenges in implementing treat to target strategies in rheumatology. Rheum Dis Clin North Am 2019;45(1):101-112.
- Harrold LR, et al. The rheumatoid arthritis treat-to-target trial: a cluster randomized trial within the Corrona rheumatology network. BMC Musculoskeletal Disorders 2014;15(389):1-7.
- Grigor C, et al. Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled trial. Lancet 2004;364(9430):263-269.
- Livre blanc de la rhumatologie française 2015.
- Van der Linden MPM, et al. Long-term impact of delay in assessment of patients with early arthritis. Arthritis Rheum 2010;62(12):3537-3546.
- Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Études & Résultats, octobre 2018. Disponible sur : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/er1085-2.pdf (consulté en juillet 2022).
- Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Études & Résultats, octobre 2009. Disponible sur : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er704.pdf (consulté en juillet 2022).
- Gibofsky A, et al. Comparison of patient and physician perspectives in the management of rheumatoid arthritis: results from global physician- and patient-based surveys. Health Qual Life Outcomes 2018;16(1):211.
- Ford JA, Solomon DH. Challenges in implementing treat to target strategies in rheumatology. Rheum Dis Clin North Am 2019;45(1):101-112.
- Haraoui B, et al. Treating rheumatoid arthritis to target: a Canadian physician survey. J Rheumatol 2012;39(5):949-953.
- Burmester Get alR, et al. Evolving the comprehensive management of rheumatoid arthritis: identification of unmet needs and development of practical and educational tools. Clin Exp Rheumatol 2020;38:1056-1067.
- Gaujoux-Viala C, Gossec L, Cantagrel A, et al. Recommendations of the French Society for Rheumatology for managing rheumatoid arthritis. Joint Bone Spine 2014;81(4):287-97.
- Goekoop-Ruiterman YPM, et al. DAS-driven therapy versus routine care in patients with recent-onset active rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2010;69(1):65-69.
- Fautrel B, . Call for action: how to improve use of patient-reported outcomes to guide clinical decision making in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2018;38(6):935 947.
- Lwin MN, et al. Rheumatoid arthritis: the impact of mental health on disease: a narrative review. Rheumatol Ther 2000;7:457-471.
- Smolen JS, Landewé R, Bijlsma J, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis. 2017;76(6):960-977.
- Studenic P, Smolen JS, Aletaha D. Near misses of ACR/EULAR criteria for remission: effects of patient global assessment in Boolean and index-based definitions. Ann Rheum Dis. 2012;71:1702-5.
- Felson DT, Smolen JS, Wells G, et al. American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism provisional definition of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials. Arthritis Rheum 2011;63:573-86.
- O’Neill KD, et al. Importance of shared treatment goal discussions in rheumatoid arthritis—a cross-sectional survey: patients report providers seldom discuss treatment goals and outcomes improve when goals are discussed. Am College Rheumatol 2021;3(12):870-878.
- Wolfe F, Michaud K. Resistance of rheumatoid arthritis patients to changing therapy. Arthritis & Rheum 2007;56(7):2135-2142.
- Gibofsky A, et al. Comparison of patient and physician perspectives in the management of rheumatoid arthritis: results from global physician- and patient-based surveys. Health Qual Life Outcomes 2018;16(1=):211.
- Gavigan K, et al. Barriers to treatment optimization and achievement of patients’ goals: perspectives from people living with rheumatoid arthritis enrolled in the ArthritisPower registry. Arthritis Res Ther 2020;22(4):1-10.
- Sepriano A, et al. Adherence to treat-to-target management in rheumatoid arthritis and associated factors: data from the international RA BIODAM cohort. J Rheumatol 2020;47(6):809 819.
- Kvien TK, et al. Considerations for improving quality of care of patients with rheumatoid arthritis and associated comorbidities. RMD Open 2020;6(2):1-12.
- Kaneko Y, et al. Assessment of discordance of treatment satisfaction between patients with rheumatoid arthritis in low disease activity or in remission and their treating physicians: A cross-sectional survey. Modern Rheumatol 2021;31(2):326-333.
- Madeleine Akrich, Florence Paterson, Vololona Rabeharisoa. Synthèse de la littérature sur les Patient-Reported Outcomes (2010-2019). 2020.
- Fautrel B, et al. Call for action: how to improve use of patient-reported outcomes to guide clinical decision making in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2018:38:935-947.
- Azevedo R, et al. Smartphone application for RA self-management: cross-sectional study revealed the usefulness willingness to use and patients’ need. Rheumatol Int 2015;35(10):1675-1685.
- Benham, et al. A patient‐centered knowledge translation tool for treat‐to‐target strategy in rheumatoid arthritis: patient and rheumatologist perspectives. Int J Rheum Dis 2021;24(3):355 363.
- Kvrgic, et al. Like no one is listening to me: a qualitative study of patient-provider discordance between global assessments of disease activity in rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res 2018;70(10):1439 1447.
- Gossec L, et al. Recommendations for the assessment and optimization of adherence to disease-modifying drugs in chronic inflammatory rheumatic diseases: a process based on literature reviews and expert consensus. Joint Bone Spine 2019;86(1):13-19.
FR-IMMR-220104 - 07/2022